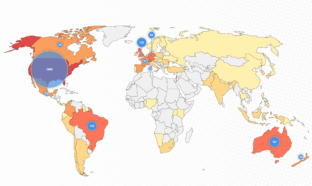Pour endiguer une criminalité verte en plein essor, l’État a musclé son dispositif répressif, en adaptant son système judiciaire et en créant des entités spécialisées dans la délinquance environnementale. Mais il reste des progrès à faire.
Au printemps 2024, plus de 70 personnalités, dont les anciennes ministres Corinne Lepage et Christiane Taubira, le climatologue Jean Jouzel, le photographe Yann Arthus-Bertrand ou la navigatrice Isabelle Autissier signent dans le « Nouvel Obs » une lettre ouverte à Emmanuel Macron. « Nous demandons justice pour l’environnement », écrivent-ils.
Face à une éco-délinquance en plein essor, les signataires dénoncent le manque de magistrats et d’enquêteurs spécialisés et une réponse pénale « dérisoire ». Ils réclament plus de moyens pour les tribunaux, des juges mieux formés et une législation plus sévère. Bref, ils veulent faire de la justice environnementale une vraie « priorité nationale ».
C’est que le tableau est assez sombre : trafics de déchets, d’espèces protégées, de pesticides, vols de bois, pollutions d’espaces naturels… Entre 2015 et 2019, les parquets ont été saisis de plus de 80 000 affaires de ce type et le chiffre ne cesse d’enfler. L’environnement est devenu, avec l’espace cyber, l’un des nouveaux terrains de jeu du crime organisé.
Devant la montée en puissance du phénomène, la France a musclé son dispositif répressif. En plus des douanes en première ligne dans ces affaires, des services spécialisés ont vu le jour comme l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et la santé publique (OCLAESP) de la gendarmerie en 2004, suivi en 2020 par l’Office français de la Biodiversité (OFB) fort de ses 1 700 agents de police judiciaire.
Un pôle dédié dans chaque cour d’appel
Du côté de la justice, une étape essentielle est franchie en 2020 avec la création sur le territoire de chaque cour d’appel d’un pôle régional environnement regroupant des procureurs et des juges affectés à la lutte contre la délinquance environnementale. En une vingtaine d’années, la France a adapté son système judiciaire et la loi Climat et résilience de 2021 a durci les sanctions pénales.
Mais il reste des progrès à faire. Parmi les pistes envisagées figurent la création d’un service national d’enquête spécialisé et l’idée, beaucoup moins consensuelle, d’un parquet national de l’environnement sur le modèle du Parquet national financier. Une machine de guerre policière et judiciaire qui a déjà fait ses preuves en Espagne.