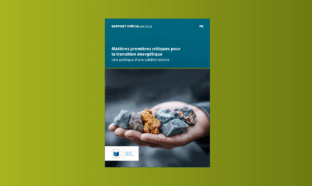Joseph Dellatte est chercheur et responsable des études Climat, énergie et environnement à l’Institut Montaigne et chercheur associé à l’Université de Kyoto, au Japon. Il estime que l’Europe, paralysée par ses divisions internes, sacrifie l’une de ses rares longueurs d’avance économique : la clarté climatique. Et envoie un signal désastreux aux industriels, aux investisseurs et à ses partenaires.
Le choix récent de reporter la décision sur l’objectif climatique européen de 2040 au Conseil européen, donnant un droit de veto à des États notoirement hostiles à l’ambition climatique, n’est pas une simple péripétie institutionnelle. C’est une erreur stratégique majeure. En brouillant le cap de la transition, l’Europe envoie un signal désastreux aux industriels, aux investisseurs et à ses partenaires internationaux. Ce recul n’est pas seulement un affaiblissement diplomatique ; c’est une perte de cap économique, à un moment où la lisibilité des trajectoires est cruciale.
Le flou climatique est un chaos économique
Dans un monde où les décisions d’investissement se chiffrent en milliards et s’anticipent sur dix ou quinze ans, l’indécision européenne a un coût. Reporter l’interdiction des moteurs thermiques, revenir sur la trajectoire 2040, ouvrir la porte à trop de flexibilité via des crédits carbones internationaux : tous ces renoncements brouillent les repères. Elles injectent de l’incertitude dans un processus de transition qui, pour être viable, doit reposer sur des signaux politiques forts et durables. Ce n’est pas une question idéologique : c’est un besoin structurel de l’économie réelle.
Deux modèles dominent déjà, l’Europe regarde ailleurs
Pendant que l’Europe se déchire, le monde avance. Et vite. Les États-Unis, malgré le virage climatique de Biden avec l’Inflation Reduction Act, signent avec Trump le retour de la pérennisation de leur rente fossile.
La Chine, premier émetteur mondial, fait un autre choix : celui de la conquête des industries propres. Malgré une industrie très carbonée et une place centrale accordée à la sécurité énergétique, elle atteint son pic d’émissions cette année (selon les dernières estimations), et domine très largement les secteurs des cleantech : plus de 75 % des chaînes de valeur des batteries, des panneaux solaires et des véhicules électriques sont chinoises. En effet, comme montré dans la dernière note de l’Institut Montaigne sur les cleantech, elle contrôle :
- 58 % de la capacité mondiale de raffinage du lithium ;
- 65 % de celle du cobalt ;
- Et 98 % de celle du graphite.
Loin du hasard, c’est une stratégie industrielle cohérente, planifiée, et massive, qui permet à la Chine de dominer les chaînes de valeur de l’économie décarbonée.
L’Europe ? Elle excelle dans l’art de réguler, d’encadrer, de fixer des normes qui, souvent, s’imposent au reste du monde. Mais elle soutient bien moins ses industriels que la Chine et, aujourd’hui, elle remet même en question son propre modèle normatif — sans offrir de vision de remplacement. L’Europe devient-elle une usine à normes au risque de perdre ses usines ?
La clarté induit la compétitivité
L’idée que les objectifs climatiques nuisent à l’industrie est un contresens. Ce sont eux qui permettent aux acteurs économiques de planifier, d’investir, de se transformer. Ce sont eux qui créent des marchés pour les technologies propres. Ce sont eux qui justifient la mise en place de politiques industrielles ciblées.
Retarder les échéances, ajouter de la flexibilité, flouter les règles du jeu, c’est affaiblir l’un des seuls leviers qui permettent à l’Europe d’orienter son industrie dans un contexte où elle est structurellement désavantagée : coûts énergétiques plus élevés, marché unique fragmenté, et outils de protection commerciale limités. L’Europe n’a pas les moyens de rivaliser avec les subventions américaines ou le dirigisme chinois. Elle ne peut miser que sur la clarté de ses objectifs.
Ce que l’on appelle « pragmatisme », c’est souvent du renoncement
Le report de l’objectif 2040, la remise en cause de l’interdiction des moteurs thermiques en 2035, les discussions autour de l’assouplissement de la fin des quotas gratuits dans l’ETS, rien ne traduit une vision réaliste. Cela reflète l’absence de stratégie. Et en matière industrielle, ne pas choisir, c’est choisir de péricliter.
Les États membres qui exigent plus de « flexibilité » au nom de la compétitivité défendent en réalité des rentes industrielles en déclin. Ce qu’ils cherchent à différer aujourd’hui, ils devront l’assumer demain — souvent trop tard, et presque toujours à un coût plus élevé. Certes, les crédits carbone peuvent jouer un rôle pour les secteurs les plus complexes à décarboner et orienter les investissements, là où les besoins sont les plus pressants. Cependant, dans de nombreux secteurs, chaque euro dépensé pour compenser à l’étranger est un euro perdu pour la transformation locale. C’est autant d’investissements qui ne financent ni la modernisation des chaînes de production, ni l’innovation, ni l’emploi. C’est du capital industriel dilapidé — et une souveraineté industrielle mise en danger.
Une urgence : adopter un vrai plan industriel
Ce que la Chine fait aujourd’hui — déploiement massif, production locale, soutien public à l’innovation, montée en puissance industrielle — l’Europe aurait pu le faire hier. Elle peut encore le faire demain, à sa façon, mais à une condition : garder le cap.
La principale limite aujourd’hui : l’Europe a peur de son ombre (et de ses ambitions). Revenir sur une stratégie fondée sur des objectifs clairs, sans proposer en retour un plan industriel crédible, capable d’accélérer la compétitivité bas carbone, ce n’est pas du pragmatisme : c’est une reddition.
L’Europe serait donc bien inspirée de :
- Fixer l’objectif de -90 % d’émissions d’ici 2040 ;
- Confirmer et mettre en œuvre l’interdiction des moteurs thermiques en 2035 ;
- Et surtout, déployer une stratégie industrielle ambitieuse, qui finance l’innovation, soutient les nouveaux entrants, structure des chaînes de valeur locales et accompagne la demande.
Il est temps d’en finir avec les arbitrages flous et les demi-mesures. L’Europe doit choisir : soit elle construit une économie alignée avec ses ambitions climatiques, soit elle devient un supermarché — pour les cleantech chinoises et les énergies fossiles américaines.
Cette tribune est tirée d’un article d’analyse paru sur le site de l’Institut Montaigne et coécrit par Joseph Dellatte et Hugo Jennepin Reyero.