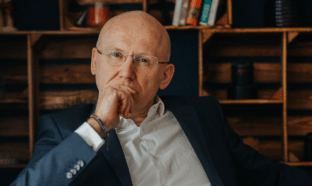Karine Vernier est directrice générale de InnoEnergy France, société européenne investissant dans l’énergie durable, et membre du Conseil national de l’industrie. Dirigeante engagée pour la décarbonation et la souveraineté de l’Europe, elle plaide pour un sursaut industriel dans la production photovoltaïque. Un « made in Europe » qui passera par des coopérations avec la Chine.
En juin 2025, l’énergie photovoltaïque était la première source d’électricité en Europe, avec près de 22 % du mix énergétique, dépassant toutes les autres énergies. Pourtant, nous importons plus de 95 % des panneaux photovoltaïques en Europe, créant ainsi une forte dépendance à l’égard de pays étrangers, et un flux d’import absolument colossal. Avec le NZIA (Net-Zero Industry Act), l’Europe a fixé un objectif de 40 % de production locale d’équipements propres d’ici 2030. Ce cadre offre une deuxième chance, qu’il convient de saisir.
Il y a vingt ans, elle dominait l’industrie photovoltaïque mondiale. L’Allemagne, pionnière avec son plan de soutien massif lancé dès 2000 (Erneuerbare-Energien-Gesetz), concentrait 70 % de la production mondiale de panneaux solaires. Mais entre 2010 et 2020, l’Europe a laissé filer cette avance, sous l’effet combiné d’un désengagement politique et industriel, et d’une offensive industrielle chinoise massive.
En 2023, la Chine contrôlait plus de 80 % de chaque segment de la chaîne de valeur solaire, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), et plus de 97 % de la production mondiale de wafers (pièces de silicium qui constituent la base des panneaux solaires). À l’inverse, la même année, l’Europe n’a produit qu’1 GW de wafers, pour une demande mondiale dépassant les 260 GW (selon les données de SolarPower Europe). Une dépendance industrielle absolue, à l’heure même où l’énergie solaire devient un pilier incontournable de notre transition énergétique. Cherchez l’erreur.
« Made in Europe », l’ambition doit devenir action
L’ambition est là. Plusieurs leviers sont déjà en mouvement et sont des avancées majeures. Citons par exemple la création de critères « non-prix » (non price criteria) dans les différentes déclinaisons nationales du NZIA, avec notamment des critères de contenu local « made in Europe » et des critères de durabilité et de résilience dans les appels d’offres publics (notamment pour les enchères solaires).
En complément, des pays comme la France, l’Allemagne et l’Espagne renforcent leurs soutiens à la création d’industries sur leurs territoires.
Des signaux prometteurs
La bonne nouvelle, c’est que l’Europe regorge d’initiatives industrielles crédibles :
- En Allemagne, NexWafe, spin-off de l’Institut Fraunhofer, développe des wafers en silicium épitaxié, plus légers et plus durables, capables de rivaliser avec les standards chinois.
- En Espagne, le projet Sunwafe ambitionne de produire 20 GW de wafers par an à partir de 2028, soit près de 50 % des besoins européens selon les projections actuelles.
- En France, la gigafactory d’Holosolis en Moselle produira l’équivalent de 5 GW de cellules et modules en Moselle. Mise en service prévue fin 2027 et puis réplication de quatre unités industrielles de taille équivalente en Europe.
- La start-up Heliup, spécialisée dans les panneaux ultralégers, a inauguré sa première ligne industrielle d’une capacité annuelle de 100 MWc en Isère, avec un plan industriel prévoyant une usine de 1 GW à horizon 2028.
Coopérer avec les industriels chinois
Après une décennie perdue, l’Europe doit faire preuve d’humilité. Il ne s’agit pas de nier l’avance de la Chine, mais de l’assumer lucidement. Pour reconstruire une filière européenne crédible, il est nécessaire de coopérer avec ceux qui savent produire à grande échelle, rapidement et efficacement.
Dans cette optique, des partenariats industriels avec des acteurs chinois peuvent représenter une voie stratégique d’accélération. Plusieurs accords allant dans ce sens ont été annoncés, avec par exemple le français Voltec et le fabricant chinois de panneaux solaires Das Solar, en juillet dernier. Plus récemment, HoloSolis signait un accord lui donnant accès au portefeuille de brevets de fabrication TOPCon de TrinaSolar.
Bien sûr, nous devons rester vigilants : ces coopérations doivent être équilibrées, orientées sur le transfert de savoir-faire, et adossées à des exigences de contenu local et de gouvernance européenne.
Ce savant dosage est sans doute l’une des clés d’une stratégie industrielle pertinente pour l’Europe : s’adosser aux savoirs acquis ailleurs sans devenir une simple zone d’assemblage.
Rediriger les politiques industrielles vers la création de valeur
L’intégration des critères de contenu local européen dans les appels d’offres, les enchères et les subventions publiques permettra de soutenir la production en Europe : sans marché pas de financement par les investisseurs (faute de visibilité) et donc pas d’usine.
Bien sûr, les panneaux produits en Europe seront plus coûteux que leurs équivalents chinois, mais un rapport de SolarPower Europe et de Fraunhofer ISE de 2025 indique qu’avec des politiques adaptées, l’écart de coût entre modules produits en Europe conformes au Net-Zero Industry Act et modules importés de Chine pourrait être ramené à moins de 10 %. En outre, la production locale crée des milliers d’emplois et génère des retombées économiques durables. À l’échelle de nos territoires, produire local est un atout, pas un surcoût. Il faut couper court à ces idées reçues et voir l’intérêt de notre continent dans son ensemble, ne pas se limiter à des enjeux ponctuels et court-termistes.
En 2024, l’Union européenne a installé un record de 65,5 GW de capacité solaire, et vise 750 à 816 GW d’ici 2030, selon SolarPower Europe. Les importations représentent des dizaines de milliards d’euros de valeur ajoutée perdue. La deuxième chance industrielle de l’Europe est là. Mais elle exige un sursaut.
Un sursaut politique, industriel, stratégique, avec un seul objectif en ligne de mire : produire, ici, en Europe, la valeur de notre transition énergétique.