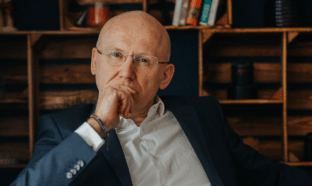Alexis Gazzo est associé du cabinet EY et responsable du département Climate Change & Sustainability France. Lors de la récente édition du salon VivaTech à Paris, il s’est exprimé sur le contexte géopolitique, livrant une analyse lucide : les stratégies de décarbonation sont prises dans un faisceau d’enjeux stratégiques de souveraineté et de compétitivité. Alors que l’administration Trump veut faire des fossiles une arme économique, la Chine joue la carte de la transition énergétique pour des raisons, entre autres, de sécurité nationale. Quant à l’Europe, elle se retrouve dans une position largement défensive.
Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a réactivé une posture pro-fossile, portée par le slogan « Drill, baby, drill ». Cette posture marque une inflexion par rapport à son premier mandat. En effet, en dépit d’une politique fédérale peu favorable à la transition énergétique, les choses avaient finalement beaucoup avancé pour les énergies renouvelables, sous l’impulsion des États, y compris des États républicains, comme le Texas. Pour ce deuxième mandat, le constat est différent. On sent une présence très forte autour de Trump des pétroliers, avec une politique très agressive en faveur des énergies fossiles pour des questions de souveraineté et de compétitivité de l’économie américaine.
Des décisions ont été prises rapidement pour renforcer les taxes sur les équipements renouvelables chinois, avec une volonté assumée de freiner l’Inflation Reduction Act (IRA) lancée par Joe Biden. Le projet de loi « One Big Beautiful Bill Act », adopté à la Chambre des représentants mais incertain au Sénat, prévoit l’arrêt progressif des crédits d’impôt pour les projets industriels dans le solaire, l’éolien ou encore l’hydrogène, à l’horizon 2028 – ou 2032 selon les segments. Pour les projets de déploiement, les délais sont encore plus serrés : seuls ceux qui auront démarré leur construction dans les 60 jours suivant l’adoption du texte pourraient conserver leur éligibilité. En résumé, il faudra sortir la pelle et la pioche très rapidement, ou renoncer.
Dans cette logique de l’administration Trump, faire du renouvelable serait faire le jeu de la Chine. Le discours est offensif, et semble aligné sur celui de pays comme la Russie ou l’Arabie Saoudite, avec lesquels les États-Unis partagent désormais une posture fossile décomplexée.
Pendant ce temps, le prix du pétrole remonte à cause des tensions au Moyen-Orient. L’administration affiche une position ambivalente : elle soutient le pétrole, mais avec un prix plancher autour de 65 $/baril pour que les projets restent rentables. Or les forages ralentissent, et certains anciens puits ferment. Sur le gaz, en revanche, les producteurs américains profitent pleinement de la fin des importations russes en Europe.
Un impératif de sécurité nationale pour la Chine
De son côté, la Chine poursuit une décarbonation massive, tout en restant très consommatrice de charbon. Les investissements prévus dans le charbon en 2025, sont de l’ordre de 54 Mds$, ce qui est énorme. Mais sur les énergies renouvelables, c’est quasiment dix fois plus.
Le pays domine aussi la chaîne de valeur sur les technologies clés : 90 % pour le solaire, près de 80 % pour les batteries, plus de 60 % pour l’éolien. Ce leadership industriel lui permet d’imposer un soft power climatique très efficace, notamment dans les États du Sud (Inde, Pakistan, Arabie Saoudite…), qui sont les premiers marchés des exportateurs chinois aujourd’hui.
Sur le terrain de la mobilité, la Chine a déjà atteint en 2024 l’objectif que les États-Unis s’étaient fixé pour 2030 : un véhicule vendu sur deux est électrique. Pendant ce temps, Trump annule purement et simplement cet objectif aux États-Unis.
Mais l’ambition chinoise ne répond pas seulement à des enjeux industriels ou climatiques : elle est aussi stratégique. La Chine ne contrôle ni le gaz ni le pétrole, qu’elle doit importer massivement. Cette dépendance constitue un point de vulnérabilité, notamment en cas de situation militaire : un blocage du détroit d’Ormuz ou du détroit de Malacca, par exemple, empêcherait une part significative des approvisionnements chinois d’arriver à destination. Ce scénario, longtemps jugé théorique, est aujourd’hui pris au sérieux. À ce titre, la décarbonation est pour la Chine un impératif de sécurité nationale.
La bataille ne se joue pas que sur les technologies. Les terres rares et les métaux critiques sont au cœur de nouvelles dépendances. La Chine est en position ultra-dominante et maîtrise quasiment 90 % du raffinage de métaux comme le cobalt et le nickel. Elle impose depuis décembre 2024 des restrictions à l’exportation de certains métaux vers les États-Unis, et discute avec l’Europe de la mise en place d’un « canal vert » d’échange contre un accès préférentiel au marché des véhicules électriques chinois.
L’Europe sur la défensive
L’Europe, quant à elle, navigue dans une zone de turbulences stratégiques. Dépourvue de ressources fossiles abondantes et dépendante pour l’accès aux métaux critiques, elle se retrouve dans une posture défensive. L’enjeu est donc clair : il faut transformer la transition énergétique en outil de souveraineté et de compétitivité.
S’ajoute à cela une réalité politique souvent sous-estimée : l’Europe reste un ensemble de 27 pays avec des normes différentes, des priorités parfois opposées. Certains États membres, comme ceux d’Europe de l’Est, n’ont pas les mêmes intérêts industriels ou climatiques que la France ou l’Allemagne. Même ces deux dernières ont parfois des visions énergétiques opposées. Cette complexité freine l’émergence d’une politique commune cohérente : la transition à 27 ne peut pas se faire sans se heurter à des divergences profondes.
Le Vieux Continent a pourtant des atouts : il est pionnier sur l’éolien offshore, sur l’efficacité énergétique, il dispose d’une forte capacité d’épargne et une volonté de réguler les marchés. Mais l’Europe peine à créer un environnement propice à l’émergence de « champions industriels ». Les déboires de certaines gigafactories comme la société suédoise Northvolt, dans le domaine des batteries Li-ion ou la société McPhy dans l’hydrogène en sont deux exemples. La conséquence néfaste derrière ces projets qui n’aboutissent pas ? Les investissements publics et privés s’évaporent, et il est compliqué de faire revenir des investisseurs sur ces technologies.
Pour ne pas voir sa transition freinée par des choix étrangers ou des dépendances critiques, l’Europe doit agir vite. Cela suppose d’assumer le coût de la souveraineté, de sortir du fétichisme du « prix bas », l’alpha et l’oméga de la politique de compétitivité européenne, et d’adopter une stratégie industrielle alignée sur ses objectifs climatiques.