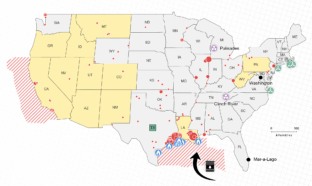Pierre-Étienne Franc est le cofondateur et directeur général de Hy24, le plus gros gestionnaire de fonds mondial spécialisé dans l’hydrogène décarboné. Dans son livre « Sauver le monde pour le changer (et pas l’inverse) »*, il constate que le dirigisme a permis à la Chine de dominer l’industrie mondiale et de devenir le leader des énergies vertes. Un contraste saisissant avec les démocraties européennes et notamment la France, piégée dans un attentisme mortifère. Pour lui, « nos sociétés sont à un point de bascule, écologique et géopolitique qui leur impose de reprendre le contrôle de leur destin ».
En juin dernier, nous avons organisé une visite du site de production d’acier décarboné Stegra, en construction dans le nord de la Suède, dans lequel Hy24 a investi.
En ce jour de juin, autres lieux, même sujet. Le matin, le Parlement français, en format opportunément réduit, suspend le soutien aux énergies renouvelables. Sidération.
Le même jour, les chiffres des déploiements d’énergie renouvelable en Chine tombent. Près de 100 GW de photovoltaïque installés en mai 2025 : l’équivalent de l’ambition française en la matière cumulée jusqu’en 2050 !
Trois moments, trois images de la transition, de notre avenir commun. Prime au dirigisme ?
Ce qui se joue est potentiellement plus important. Le dirigisme semble avoir permis à la Chine d’être devenue non l’usine, mais l’industrie du monde, avec des chaînes de valeur, des terres rares aux chaînes de production automatisées, qui contrôlent plus de 50 % du marché dans les principaux secteurs industriels et notamment les énergies décarbonées (batterie, solaire, éolien, hydrogène et ses dérivés et nucléaire). Mais ce qui frappe en Chine, c’est que ce sont ceux qui avancent qui gagnent et ceux qui attendent qui perdent. En Chine, c’est le marché qui avance ! La concurrence est intense, agile, avec des centaines d’acteurs sur chaque grand secteur, très entrepreneuriale et agressive. Schumpeter dans le pays de Mao.
L’État ne choisit pas les vainqueurs : il s’efforce de permettre à des marchés de croître à l’export et sur son sol. Le renouvelable mondial en bénéficie directement. Les prix du solaire ont été divisés par plus de dix en vingt ans. Ils atteignent aujourd’hui la parité du marché dans la plupart des géographies. Peut-être est-ce d’abord parce qu’ils tirent parti d’une politique centrée sur la stabilité : stabilité institutionnelle et sociale évidemment, mais aussi stabilité des signaux donnés aux acteurs économiques. En matière de transition, elle relève d’une triple injonction : souveraineté énergétique, compétitivité, urgence écologique immédiate (climat, qualité de l’air et de l’eau). Enfin, c’est devenu, plus encore depuis le retrait américain de la bataille climatique, un sujet de leadership moral. Les enjeux sont similaires aux nôtres, que nous manque-t-il ?
Une approche patrimoniale de l’énergie
Poursuivons. La France n’a jusqu’à présent pas su — ou voulu — développer assez sa ressource renouvelable : complexités administratives, portage politique faible, contraintes du territoire (ensoleillement inégal, conflits d’usage des façades maritimes, etc.). Elle tire parti de son parc nucléaire existant (mais la compétition renouvelable et le stockage des voisins progresse vite), et doit relever le défi du renouvellement du parc. Nous n’aurons pas les meilleurs prix, mais la souveraineté passe par une approche patrimoniale de notre énergie qui consiste à se déprendre de nos dépendances aux flux fossiles importés en électrifiant les usages et en leur substituant progressivement des sources d’énergie décarbonées. Il faut chercher (énergies décarbonées, électriques ou non) ce qui est produit sur notre sol européen et qui est « souverain ». Et ce qui l’est sur des terres voisines et amies, qui offre une « souveraineté d’accès ». Dans ce contexte, le spectacle d’attentisme offert par le monde politique est sidérant. Nul ne sait de quoi est fait l’avenir, mais il ne sera pas sans une souveraineté durable sur l’énergie.
Résultat : en France, ceux qui attendent sont souvent gagnants, parce que les lois et les budgets ne sont jamais sûrs. Comment fabriquer avec cela une nation d’entrepreneurs mondiaux ?
Les entrepreneurs à la tête de Stegra sont-ils inconscients ? Non. Leur vision est supportée par le cadre réglementaire (le CBAM) qui accompagne la montée en puissance de l’acier vert. Il est européen, c’est le seul espace pertinent pour ces sujets. Il taxera demain notamment l’acier carboné entrant aux bornes de l’Europe pour protéger nos efforts. Ces règles stables offrent une certaine prévisibilité qui permet au marché de jouer son rôle. Et l’Europe a un impact mondial parce que c’est le principal importateur sur ces produits énergétiques clefs.
Point de bascule
Mais la politique réglementaire en Europe reste fragile et provoque l’attentisme des acteurs : gouvernance complexe, lenteurs de décision et d’exécution — car intermédiées par les États membres —, absence de politique budgétaire et monétaire propre pour le climat. Tout ce que l’Europe essaie de faire est nécessaire. Ce n’est pas d’un autoritarisme dont elle a besoin. Notre « dirigisme », ce sont nos règles, mais plus vite, plus efficace, plus simple, pour que le marché déploie vite.
Le marché n’a ni cœur, ni âme, ni dessein autre qu’un principe de rationalité économique, dans le cadre de ce que la société lui permet ou lui demande de faire. Ce sont les règles du jeu. Les plus claires, les plus rapides et les plus stables gagnent. Ainsi, la question n’est pas le marché ou le dirigisme, mais l’efficacité dans la décision démocratique et la gouvernance européenne. Comment revenir aux fondements de la volonté générale, telle qu’imaginée par Rousseau, qui suppose qu’électeurs et élus soient capables de se prononcer au nom du bien de tous et non de leur intérêt propre ? Question, non pas à la démocratie, mais à l’individualisme de marché qui a influencé notre comportement politique et lentement dénaturé la fonction démocratique, au point de la rendre improductive. Faillite du peuple ? Faillite à se construire collectivement un projet qui donne envie à chacun de penser pour les autres.
Nous sommes à un point de bascule, écologique et géopolitique qui impose aux sociétés de reprendre le contrôle de leur destin. Leur premier impératif est d’aligner une partie des intérêts individuels sur les urgences collectives, à commencer par l’enjeu écologique. C’est une opportunité énergétique et de souveraineté, et la possibilité de renforcer le projet européen. Saura-t-on collectivement revisiter le champ de nos désirs pour garder la liberté de nos rêves ? C’est la question qui vient. »