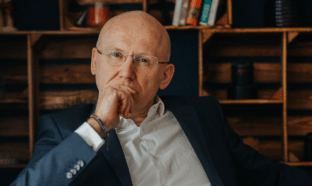Invité du dernier Club 2050NOW le 2 avril dernier – au côté de Thomas Buberl, directeur général du groupe AXA et de Sylvie Goulard, professeure à la SDA Bocconi -, François Gemenne, professeur à HEC, a plaidé pour que nous nous délivrions d’une « obsession américaine » qui nous empêche d’agir. Nous retranscrivons ici une partie de ses propos.
« Face aux crises qui nous assaillent, nous regardons beaucoup trop du côté des États-Unis. Cette obsession nous rend aveugles aux évolutions du monde, et nous fait faire de mauvais choix.
Notre fascination morbide pour ce grand pays ressemble à la manière dont les gens se comportent souvent sur l’autoroute quand ils voient un accident sur la bande d’en face : ils s’arrêtent pour regarder ce qui se passe…
Nous avons la même attitude vis-à-vis des États-Unis.
Les grandes plaques tectoniques qui bouleversent le monde vont pourtant venir de Lagos, de Mexico, de Jakarta, de Téhéran, de Moscou ou évidemment de Delhi, bien davantage que de Washington.
Bien sûr, il ne faut pas minimiser l’importance de ce qui se passe aux États-Unis, ni le cours d’un régime qui défie l’état de droit, ni l’importance du déclassement des universités américaines, ni la régression sur le climat. Mais si nous prêtions un peu moins d’importance à ce qui se passe à Washington et un peu plus d’importance à ce qui se passe ailleurs, nous parviendrions grandement à atténuer les effets de l’influence américaine sur la posture des autres pays, y compris en matière de climat.
Pourquoi avons-nous tendance à reculer sur toute une série d’autres sujets, y compris l’engagement environnemental des entreprises ? Parce que nous regardons ce que fait M. Trump à Washington, et qu’on se dit soudain que si le président des États-Unis dit ceci, alors nous devrions nous positionner comme cela.
L’Inde vient par exemple de dépasser un seuil de production de charbon d’un milliard de tonnes cette année. Cette production gigantesque constitue un momentum dans l’histoire énergétique de l’Inde. Personne n’en a parlé, alors qu’un milliard de tonnes de charbon extrait en Inde, c’est mille fois plus important que le « Drill, Baby Drill » de Trump. D’autant que les Américains ne vont pas pouvoir creuser beaucoup plus que ce que les permis d’exploitation accordés par Joe Biden leur ont déjà autorisé.
Cette obsession américaine nous détourne aussi de ce que nous devrions faire en Europe. Je suis frappé par la manière dont certains ont volontiers tendance à distinguer les questions de défense et les questions de transition. J’entends ainsi une petite musique qui a dit « attention, si nous investissons dans le réarmement et la défense de l’Europe, ce sont des fonds qu’on ne pourra plus utiliser pour la transition, on va déshabiller Paul pour habiller Pierre… »
Notre transition énergétique, climatique et écologique en général est en réalité une question de souveraineté.
Notre faiblesse en matière énergétique est aussi une faiblesse en matière industrielle. Le prix de l’électricité est trop élevé pour les entreprises européennes et nous dépendons évidemment des énergies fossiles, que nous achetions du gaz à Russie ou que nous devions acheter du pétrole au premier producteur mondial de pétrole qui se trouve être les États-Unis. On voit bien que cette dépendance aux énergies fossiles constitue un risque considérable en terme géopolitique. C’est un handicap pour nos industries, notamment nos industries lourdes qui ont des besoins énergétiques et d’électricité considérables.
Un certain nombre de verrous sont enfin en train de sauter, sur la possibilité de contracter une dette commune européenne, sur les questions de recours à l’épargne des particuliers, sur les questions de défense. Mais il faut maintenant que cela se concrétise et mettre en place les mêmes mécanismes pour financer l’innovation, car ces enjeux sont liés les uns aux autres.
Notre obsession américaine nourrit aussi notre obsession pour l’État. Nous avons tort de considérer que la transition va reposer quasiment exclusivement sur les épaules des gouvernements. Surtout en France.
J’ai au contraire la conviction que la population et les entreprises sont en réalité davantage prêtes à s’engager que les gouvernements, pas seulement en France mais globalement en Europe. L’impulsion vient aujourd’hui largement des entreprises, et il faut le dire, des collectivités, des municipalités qui font des choses souvent assez formidables en termes d’engagement pour la transition.
Comment aider les entreprises à transitionner plus rapidement ? Comment faire en sorte qu’elles aient un intérêt économique et financier en termes de rentabilité, qu’elles y trouvent aussi potentiellement un intérêt en termes de réputation pour attirer les meilleurs talents ? La question de la réglementation européenne est évidemment très importante, notamment pour valoriser celles qui s’engagent. Mais l’écologie politique a commis une erreur gravissime en considérant les entreprises comme des adversaires de la transition.
Bien sûr, il y a des entreprises qui freinent, ne soyons pas naïfs. Mais je crois qu’il faut aujourd’hui utiliser les entreprises comme des leviers de transformation de la société. L’engagement social des entreprises transforme leur rôle.
Enfin, si nous voulons positionner les entreprises européennes à l’avant-garde de l’économie du XXIe siècle, il faut leur donner les moyens et développer leur financement. Nous avons un atout dont nous ne profitons pas : l’Europe est le continent qui épargne le plus. L’épargne des seuls Français est comprise entre 6 000 et 8 000 milliards d’euros. Mais cette épargne nourrit aujourd’hui la capitalisation des entreprises américaines ! Qu’est-ce qui fait d’Elon Musk l’homme le plus riche du monde ? C’est l’énorme capitalisation boursière de Tesla qui lui permet d’autres activités comme le rachat de Twitter pour influencer le débat public. Tesla a une capitalisation boursière qui dépasse celle de l’ensemble des autres constructeurs automobiles.
Et pourquoi Tesla bénéficie-t-elle d’une telle capitalisation boursière ? Parce que les Européens ont suivi les recommandations de leur banquier au moment de placer leur épargne dans des fonds d’action qui dépendent largement d’entreprises américaines. Sans le savoir vraiment, des millions d’Européens ont des actions de Tesla, d’Apple, de Facebook, d’Alphabet…
Tant que l’Europe n’aura pas réussi à inverser cette tendance, elle gardera une faiblesse industrielle. Mais si l’Europe réussit à réorienter massivement cette épargne vers les entreprises du continent, alors sa force et sa souveraineté en seront décuplées. »