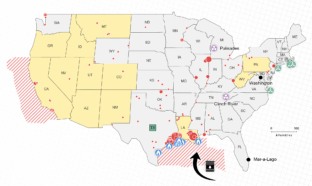Laurence Tubiana, considérée comme l’architecte de l’accord de Paris sur le climat, a débattu avec la ministre de la transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, lors du Forum de Giverny dont WARM by 2050NOW était partenaire le 5 septembre. Les deux femmes politiques ont échangé sur la stratégie de la France et de l’Europe pour garder le cap dans un monde hostile, à quelques semaines de la COP30 au Brésil. Extraits.
Laurence Tubiana : Je voudrais vous dire que ce n’est vraiment pas le moment de déprimer et qu’en plus ça ne sert à rien ! Je citerais volontiers la très belle phrase de Victor Hugo, « il faut étonner la catastrophe par le peu de peur qu’elle nous fait ». Regardons le chemin accompli depuis l’accord de Paris, en seulement dix ans. L’année dernière, deux tiers des investissements dans l’énergie l’ont été dans les énergies renouvelables, et un tiers dans les énergies fossiles. C’était exactement la proportion inverse il y a seulement trois ans.
Le 12 décembre 2015, je n’aurais jamais imaginé que les véhicules électriques — chinois d’ailleurs, il faut reconnaître — commenceraient à dépasser les véhicules à l’éthanol dans un pays comme le Brésil. Je n’aurais jamais imaginé que les prix des batteries auraient diminué de 90 %. Tout comme le fait que les coûts du solaire et même de l’éolien aient chuté fortement… Nous avons aussi réussi cette année ce qui paraissait impensable en 2015, demander au transport maritime de se décarboner… Nous sommes donc entrés dans un monde technologiquement différent et c’était l’idée même de l’accord de Paris qui portait cette vision du futur de la transition énergétique.
Beaucoup d’entreprises et de gouvernements y ont cru et y croient encore. Et puis, regardons les scénarios des scientifiques sur l’augmentation des températures : avant l’accord de Paris, nous étions à + 3 ou même + 4 °C ; aujourd’hui, on est probablement autour de 2,5 °C. Des gens vraiment très indépendants, comme Carbon Tracker Initiative – un grand think tank qui mesure les évolutions – estiment qu’on pourrait être très en dessous des 2 °C, notamment parce que les émissions de la Chine commencent à se retourner. Nous sommes donc dans un tout autre monde que celui d’avant l’accord de Paris.
Mais reconnaissons-le, ça ne fait pas plaisir à tout le monde et à ceux qui font du gaz, du pétrole… et qui ont des marges confortables. Quand l’Agence internationale de l’énergie affirme que la demande d’énergie fossile, en particulier de pétrole, va baisser, c’est très mauvais pour les bénéfices, même quand les poches sont déjà très profondes. L’agressivité des lobbies pétroliers est devenue vraiment problématique — et je n’aime pas parler comme ça, je ne suis jamais simpliste — mais là, franchement, pour quelqu’un qui s’occupe du climat depuis trente ans, je n’avais jamais vu ça, jamais.
Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un moment critique : ces lobbies se disent à juste titre que s’ils ne bloquent pas cette transition maintenant, investisseurs et assureurs vont prendre peur et se dire que cela devient vraiment trop dangereux de continuer comme ça avec les fossiles.
Et je regrette de voir qu’en Europe, beaucoup sont sensibles au changement de cap américain. On ne va quand même pas laisser à Pékin le modèle de la transition écologique ? On ne va quand même pas renoncer à l’identité européenne et laisser des régimes dont on ne partage ni le mode de vie, ni le régime politique, aller plus vite que nous et gagner ces marchés ?
Je me souviens qu’en décembre 2009, pour ceux qui ont été comme moi au sommet de Copenhague, nous sommes tous rentrés extrêmement déprimés. Et au début du mois de février 2010, le bureau politique du Parti communiste chinois a fait une semaine de réunion sur le changement climatique et la transition. Ils se sont dit, « c’est le moment d’y aller », et ont bâti leur stratégie sur le véhicule électrique, les matériaux critiques, les batteries, le solaire et l’éolien, toute une filière industrielle de la transition. Nous avons pris du retard en Europe et aussi en France, et c’est notre moment : il faut bien réaliser ce que nous coûtent les importations de pétrole et de gaz, c’est considérable. Ce n’est ni bon pour notre balance commerciale, ni pour notre souveraineté.
Agnès Pannier-Runacher : Il s’est effectivement passé beaucoup de choses depuis l’accord de Paris. Si on prend le cas de la France, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 24 % ces sept dernières années. Personne n’aurait imaginé il y a dix ans une telle performance.
La Chine, de son côté, est en passe d’atteindre son pic d’émission, cinq ans avant son objectif officiel. Sur les énergies renouvelables, Pékin a également cinq ans d’avance. Certes, sa tactique est en règle générale de sous-promettre, ce qui lui permet de dire qu’elle sur-délivre… Elle tire bénéfice de cette tactique auprès des pays en développement, là où l’Europe, emportée par sa volonté d’être la locomotive mondiale, a tendance à sur-promettre et à péniblement délivrer ou parfois sous-délivrer, face à ses objectifs ambitieux.
Il y a une autre évolution fondamentale : ce n’est plus un combat pour la planète, c’est devenu un combat pour chacun d’entre nous. On l’a bien vu cet été, avec les records de chaleur, c’est maintenant, c’est votre maison qui est un peu trop près de la plage, c’est votre grand-mère qui supporte mal la chaleur, c’est vos entreprises qui sont dépendantes de matières critiques et du bon état des écosystèmes naturels… Cela va vite se voir dans les comptes de résultats des entreprises, si ce n’est pas déjà le cas… La Banque centrale européenne, qu’on ne peut pas soupçonner de militantisme échevelé, estime que 72 % des emplois sont liés au bon état des systèmes naturels. Il s’agit donc d’un combat économique et également géopolitique, via l’accès à des ressources essentielles et rares qui avive la conflictualité.
L’eau, l’énergie, l’alimentation, les matières premières… Pour toutes ces ressources, il y a des limites physiques qui vont transformer cet enjeu économique en enjeu de souveraineté avec des risques majeurs de conflictualité dans les années qui viennent.
Quelle sera la position de la France lors de la COP30 en novembre au Brésil ?
Agnès Pannier-Runacher : La position de la France est constante, c’est la neutralité carbone en 2050. C’est aussi l’objectif de l’Union européenne. La neutralité carbone en 2050 suppose des points de passage crédibles si on veut réellement l’atteindre. Telle est notre position — celle d’une négociation qui peut être perçue comme dure mais nécessaire. On affirme que l’ambition climatique est une nécessité absolue pour le continent européen, mais pour y parvenir il faut un réalignement de nos politiques européennes, et d’abord de notre politique commerciale. Les épisodes récents avec les États-Unis en soulignent la nécessité : réaligner politique commerciale, politique de compétitivité industrielle et d’innovation, politique énergétique, cadre de nos aides d’état… Réaligner tous ces différents aspects pour qu’à la fin, on ne rate pas la trajectoire.
Je dis ici que la France a enregistré une victoire historique en juillet dernier avec la reconnaissance de la neutralité technologique : le nucléaire fait bien partie des technologies qui vont nous permettre d’atteindre la neutralité carbone.
Laurence Tubiana : Nous avons besoin que des voix venues des entreprises, des secteurs économique, financier et industriel, s’expriment de façon claire pour dire qu’il ne faut pas changer le cadre du Green deal et nos ambitions européennes. Il y a un tel brouillage politique aujourd’hui, qu’on semble perdre le sens de la direction. La Chine va continuer à avancer et annoncer un nouveau plan climat en septembre. Il y a évidemment des discussions euro-chinoises même si la question ukrainienne complique la discussion politique avec Pékin.
La Chine est sans doute, parmi les grands pays émergents, le pilier le plus solide, avec le Brésil évidemment, pour défendre l’ambition de l’accord de Paris. Et sans cet accord, la Chine ne pourrait pas continuer à développer ses exportations sur lesquelles repose son grand pari industriel. Nous avons donc un pouvoir d’entrainement et un allié objectif, bien sûr avec les difficultés qu’on connaît. On a besoin d’une Europe qui dise, « nous aussi on continue » et il faut le dire dès maintenant. La Chine peut faire beaucoup plus s’il y a un effet d’entraînement. On peut faire beaucoup plus si on a des coopérations avec d’autres, et coopérations, ça veut dire que chacun fait davantage. C’est ce qu’on appelle une conditionnalité. On l’a déjà expérimenté lors du sommet de Copenhague, on pourrait le rejouer maintenant.
Enfin, et ce sera extrêmement difficile, nous avons besoin de discuter avec des partenaires cruciaux — l’Afrique du Sud, de nombreux pays africains, le Brésil, mais aussi l’Indonésie, la Thaïlande… dont nous allons dépendre des exportations de matériaux critiques. Qu’est-ce qu’on peut leur offrir dans un contexte économique tendu et dans une configuration européenne où l’on prend toujours beaucoup de temps dans des discussions internes pour se mettre d’accord ?
L’Europe a besoin d’exister sur la scène internationale, et elle est en train de disparaître. Il faut écouter tous ceux qui influencent l’administration américaine, y compris le vice-président. Pour eux, l’ennemi, ce n’est pas la Russie, c’est l’Europe. Et pourquoi l’Europe ? Précisément parce qu’on a choisi d’aller vers la transition écologique. Il y a chez eux une dimension idéologique – Greta Thunberg présentée comme l’antéchrist – mais pas seulement : ils veulent de l’énergie à tout prix, ils veulent que le secteur pétrolier et gazier américain gagne la bataille. Ne soyons surtout pas naïfs.
Le succès de l'accord de Paris fut le succès du multilatéralisme. Est-ce que cette mécanique internationale peut encore fonctionner sans les États-Unis et dans un monde où les tensions géopolitiques ont pris le dessus ?
Laurence Tubiana : Je le crois mais on ne pourra pas avoir exactement la même forme de négociation. La volonté affichée de l’administration américaine de faire pression sur certains pays, en les menaçant de droits de douane exorbitants pour qu’ils renoncent à leur politique climatique, donne une idée de la bataille qui démarre. Beaucoup de pays se tournent vers l’Europe pour tenter de trouver des parades. C’est là où il nous faudra faire des ouvertures. C’est ça, je le crois, le futur du multilatéralisme : lier finance, commerce, transition écologique et coopération technologique dans des coalitions où l’on fera sans les Américains. Il y a des pays prêts à entrer dans cette dynamique.
Agnès Pannier-Runacher : Regardons à nouveau le verre à moitié plein. Depuis le début de l’année, on a signé un accord sur la COP biodiversité, alors que la négociation lors de la COP de Cali s’était arrêtée via un artifice. En réalité, l’Union européenne avait haussé le ton. Les pays sont revenus ensuite à la table dans un état d’esprit plus constructif, et ça a fonctionné. Puis en avril, on a signé un accord historique à l’Organisation maritime internationale, où les entreprises elles-mêmes se sont engagées sur un dispositif de bonus-malus au niveau international. Enfin lors de la Conférence des Nations unies sur les océans, il y a eu des avancées significatives, notamment sur un traité qu’on traînait depuis une vingtaine d’années, et qui sera ratifié dans l’année sur la protection des hautes eaux.
Force est de constater que le multilatéralisme fonctionne dans les faits. La COP28, à Dubaï, a aussi marqué un moment clé où on a enfin formulé l’indicible — la sortie des énergies fossiles – qui a été d’ailleurs extraordinairement mal vécue par les pays producteurs. Il est vrai que cette avancée a créé un effet de résistance très fort, notamment de l’Arabie Saoudite et du Moyen-Orient, parce qu’ils ont vu la chose leur échapper. Il ne faut pas sous-estimer leurs difficultés : il y a des pays pour lesquels la sortie des énergies fossiles est un sujet existentiel, et comme cette perspective n’est plus théorique, ils résistent violemment.
Aujourd’hui, vous avez la Russie, le Moyen-Orient et, fait nouveau, les États-Unis, qui s’organisent pour continuer à investir dans les fossiles. Mais il ne faut pas être dupe : les Américains arrivent à la fois à investir dans les fossiles et dans les technologies vertes. Business is business. Si l’Europe hésitait tout d’un coup, elle se ferait prendre de vitesse par la Chine qui continue avec à un rythme très volontariste. L’Europe ne doit pas commettre une erreur historique.