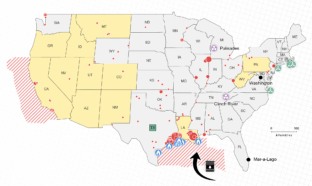Depuis l’invasion russe de février 2022, les Ukrainiens impressionnent leurs homologues européens par leur stupéfiante capacité d’adaptation et d’innovation militaire. Le pays, qui devait tomber en quelques jours, résiste encore et toujours, et les gains territoriaux de Moscou sont minimes au regard de l’engagement et du nombre de victimes. Mais il est un autre domaine qui force le respect : avoir réussi à sauver l’agriculture dans un pays ravagé par les missiles, les bombes planantes et les drones russes.
En février 2022, on surnommait encore l’Ukraine « le grenier de l’Europe ». C’est simple, on estimait que le pays nourrissait plus de 400 millions de personnes dans le monde. Europe, Afrique, Asie, la planète s’arrachait les céréales ukrainiennes. Le pays exportait tous les mois 4,5 millions de tonnes de production agricole par ses ports de la mer Noire. L’invasion russe a provoqué l’une des crises alimentaires les plus sévères de ces dernières décennies.
Le blocus immédiat de ses ports stratégiques, bombardés et minés par les assaillants, a eu des répercussions immédiates sur la sécurité alimentaire mondiale. Les prix alimentaires ont bondi de 8 % à 20 % selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). En 2022, les agriculteurs ukrainiens ont semé 22 % de moins que l’année précédente. Résultat, 2,8 millions d’hectares, soit l’équivalent de la Belgique, sont restés en friche. Les images satellites ont montré que dans les zones les plus touchées du Donbass, la végétation a largement décliné. Les stratèges russes savaient comment affaiblir l’Ukraine, à défaut de réussir à l’envahir : on estime que les bombardements et les frappes ont fait plus de 80 milliards de dollars de dégâts dans les installations agricoles. En quelques mois, les marchés mondiaux ont été privés de millions de tonnes de maïs, de blé, d’orge.
20 % des terres arables minées
Une fois le choc mondial de l’invasion russe passé, la communauté internationale a pris la mesure de la crise alimentaire. En juillet 2022, grâce à la médiation turque et sous l’égide de l’ONU, naissait « l’Initiative de la mer Noire ». Russes et Ukrainiens signent alors un accord permettant la reprise des exportations par la mer Noire et 33 millions de tonnes de céréales quittent les ports du pays. L’accord tient une année, renouvelé par périodes de 60 jours. Mais un an plus tard, le Kremlin annonce sortir de l’initiative, estimant que l’Ukraine retrouve trop de liberté de commerce. Les marchés mondiaux s’inquiètent à nouveau, et l’angoisse de pénurie alimentaire remonte en flèche.
Mais c’était sans compter sur la résilience de Kiev, son refus de capituler, y compris sur le plan agricole, et sa maîtrise du combat maritime. Les forces spéciales multiplient les coups de maîtres contre la flotte ennemie, qui finit par se réfugier dans ses ports. La marine réussit à ouvrir un corridor longeant les côtes bulgares et roumaines avant de gagner le détroit de Bosphore et les mers libres. En quelques mois, les résultats sont stupéfiants, les exportations retrouvent presque leur niveau d’avant février 2022, soutenus par une aide internationale dédiée, de la part de l’ONU et de l’Union européenne.
Plus de trois ans et demi après l’invasion russe, les perspectives sont néanmoins inquiétantes. De très nombreuses terres agricoles ont été ravagées par la guerre, d’autres sont minées pour des décennies, inutilisables. Les spécialistes estiment qu’au moins 20 % des terres arables sont minées. Il faudra des dizaines de milliards de dollars pour relancer le secteur et rendre ses vraies couleurs au blé ukrainien, dont la teinte jaune est avec le bleu du ciel le symbole du drapeau national.