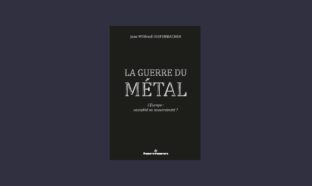[ Donald Trump a déclaré le 5 janvier 2026 avoir « besoin du Groenland du point de vue de la sécurité nationale ». Nous republions notre article sur l’histoire de ce territoire stratégique dont le sous-sol est riche en minerais critiques ]
Tout au long de l’histoire, le Groenland a fait l’objet de multiples convoitises, de la Norvège, du Danemark et des États-Unis. Depuis son investiture, Donald Trump cible ce territoire stratégique, au sous-sol riche en minerais critiques.
La légende dit que le Groenland (« pays vert ») doit son nom à Erik Le Rouge, l’un des premiers découvreurs et colonisateurs de cette terre en 982, pour y attirer des compatriotes norvégiens. Et il est vrai que, selon les historiens qui se sont penchés sur la destinée de ce territoire, il présentait de vastes étendues de forêts et de pâturages et que les colons viking, qui occupèrent le pays entre les Xe et XVe siècles, y pratiquaient l’élevage, en plus de se livrer au commerce de l’ivoire de morse et de la fourrure d’ours blanc.
Pour autant, la vie locale est restée rude, la colonie était pauvre, reliée de façon parfois très aléatoire à la Norvège ou au Danemark, au point qu’au XVe siècle, la civilisation médiévale européenne a disparu, probablement à cause du changement climatique (le « petit âge glaciaire »), de la destruction des forêts, de la concurrence de l’ivoire d’éléphant. Les Vikings sont probablement partis vers d’autres cieux, en Islande ou vers le golfe du Saint-Laurent, laissant la place aux Inuits. Et il faudra attendre 1720 pour que Danois et Norvégiens redécouvrent le Groenland et l’ouvrent progressivement au commerce avec les pays scandinaves.
Domination de la Norvège et du Danemark
Le Groenland est longtemps resté sous la domination d’une sorte de joint-venture entre la Norvège et le Danemark. Cela, jusqu’en 1380, lorsque la Norvège passe sous domination danoise. Mais les deux pays s’en sont à nouveau disputé la souveraineté au début du XXe siècle, jusqu’en 1933, année où la Cour permanente de justice internationale tranche en faveur de Copenhague. Depuis 1979, le Groenland est un territoire autonome (ses habitants se sont même prononcés par référendum en 1982 sur le retrait du Groenland de la CEE, un cas unique au sein de l’UE) qui depuis 2009 à la haute main sur les ressources de son sous-sol au titre d’une loi dite « d’autonomie renforcée » lui conférant pleine autorité sur la police et la justice tandis que le Danemark reste en charge de la politique monétaire, de la défense et de la politique étrangère.
L’intérêt ancien des États-Unis
Le destin du Groenland fut donc celui d’une terre tour à tour désirée puis abandonnée, où se sont croisées les civilisations scandinave et inuit. Mais qui, depuis le milieu du XIXe siècle est convoité par son très proche voisin, les États-Unis, qui ont tenté plusieurs fois de l’acquérir en arguant du fait que l’île fait partie de la sphère de sécurité américaine. En 1867, le président Andrew Johnson a même voulu ajouter à sa liste de course sur laquelle figurait déjà l’Alaska, le Groenland et l’Islande… Harry Truman en offre 100 millions de dollars en 1946. Et Donald Trump caresse à nouveau cette hypothèse en 2019, avant de se faire plus pressant depuis son arrivée à la Maison Blanche.
Pourquoi le sujet revient-il à nouveau sur le tapis ? Il y a toujours cette raison objective : la proximité du Groenland avec le territoire américain. Raison qui alimente, à Washington, cette vielle théorie géopolitique de la « continuité territoriale » selon laquelle le Groenland serait le pendant occidental de l’Alaska, offrant un autre poste avancé vers la Russie et surtout une ouverture vers l’Arctique et la route maritime du Nord, laquelle est aujourd’hui d’abord l’affaire de la Russie et de la Chine.
Une zone stratégique
L’autre intérêt du territoire est son potentiel économique. Il n’a pas toujours été très apparent, loin s’en faut. Mais depuis une bonne dizaine d’années, deux éléments majeurs ont musclé le jeu du Groenland : le réchauffement des températures dans l’Arctique et la guerre pour la maîtrise des minerais stratégiques.
Une étude de la revue Nature révélait en 2024 que le rythme de la fonte des glaces de l’île depuis 1985 est beaucoup plus important que ce que l’on pensait (5 000 kilomètres carrés de glace perdus) ce qui fait que le Groenland serait responsable à hauteur de 25 % à l’élévation du niveau de la mer. Or, cette terre de plus de 2 millions de kilomètres carrés, l’équivalent grosso modo de l’Arabie Saoudite ou du Mexique, est recouverte à 80 % par un inlandsis, une masse de glace qui est la plus importante du monde après l’Antarctique. Le réchauffement des températures ouvre donc des opportunités nouvelles d’exploitation des ressources du sous-sol mais aussi de nouvelles zones de pêche, sans parler du développement des activités touristiques.
Il se trouve que le Groenland recèle des gisements de quelques-uns des minerais critiques les plus convoitées comme le tungstène, la baryte, le niobium, l’antimoine, le cobalt, le lithium ou le béryllium sans parler du nickel, du cuivre ou du graphite. Le retrait progressif de la glace faciliterait donc l’exploration et l’exploitation de ces gisements. Mais pour l’heure, il ne s’agit que de perspectives. Aucun projet concret n’est encore en cours, même si une centaine de licences d’exploration ont été accordées par le gouvernement groenlandais. Pour l’instant il n’existe que deux mines en exploitation au Groenland, une d’or et l’autre d’anorthosite. L’île manque d’infrastructures terrestres et portuaires mais aussi de main d’œuvre.
Quel avenir pour le territoire ?
Donald Trump réussira-t-il là où ses prédécesseurs ont échoué ? C’est douteux car apparemment, il n’y a pas de vendeur… Il est possible que l’on s’achemine vers une voie médiane : la signature par des compagnies minières américaines de « deals » leur accordant un accès prioritaire à des projets d’extraction de minerais critiques. Une façon pour Donald Trump de sauver la face, pour le gouvernement danois de desserrer l’étau et pour le Groenland de se doter d’infrastructures modernes et d’accélérer son insertion dans le grand jeu mondial des terres rares. Mais cette solution pourrait passer pour trop raisonnable et mesurée à la Maison Blanche où l’on semble apprécier les « blitzkriegs »…