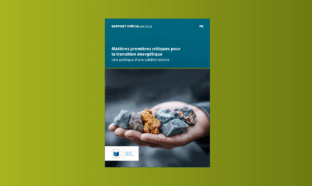Face à la « déformation du triangle stratégique États-Unis – Chine – Russie », impossible pour les dirigeants d’entreprise d’ignorer le risque géopolitique. Mais comment l’analyser et l’intégrer ? Thomas Gomart et Siméo Pont, respectivement directeur et chargé de mission auprès du directeur de l’Institut français des relations internationales (Ifri), ont étudié le « marché du discours géopolitique » qui s’est formé pour répondre à ce besoin, marché que se partagent trois grandes catégories d’acteurs : les banques d’affaires, les pure players (ex diplomates et membres de services de renseignement) et les cabinets de conseil en stratégie. Leur production – rapports, index et conseils – forment la « doxa géopolitique » pour les entreprises.
Selon les auteurs, cette doxa nourrit le scénario convenu de « continuation de la mondialisation en dépit de sa fragmentation géopolitique » et bien qu’éclairante, elle « vise moins à analyser et à prévoir des ruptures ou des bifurcations qu’à forger un consensus destiné à privilégier des géographies d’investissements ou des secteurs d’activités ».
Le duo s’intéresse particulièrement à « l’offre de géopolitique » proposée par les cabinets d’audit et de conseils et détaille les services de McKinsey, EY, KPMG, Deloitte, PwC et du Boston Consulting Group. Ils dénoncent quelques écueils : l’absence de scénarios de rupture, une offre réservée aux grands groupes et un accent trop important mis sur la « résilience » comme solution miracle. Résultat : une doxa incomplète et avant tout idéologique, selon eux, alors qu’elle doit être davantage « intentionnelle, incarnée et spécifique ».
Au sein des entreprises, le risque géopolitique reste encore trop laissé pour compte car considéré comme un « empêcheur d’affaires » sans « solutions concrètes », alors qu’aujourd’hui « les interdépendances sont davantage subies que choisies », estiment aussi Thomas Gomart et Siméo Pont. Ils avancent quelques pistes d’évolution à destination des dirigeants : traiter ce risque sous l’angle de l’exposition de leur entreprise, de sa géographie et chaîne de valeur ou encore de la nationalité de ses collaborateurs.
Conscients de la complexité du sujet et de ses enjeux, les deux experts plaident pour une « offre de géopolitique » augmentée, intégrant des apports des milieux stratégique et académique, la prise en compte des intentions des chefs d’État de scénarios plus disruptifs, et enfin, une approche locale, historique et culturelle. Et définissent un objectif : « ce qu’il faut savoir anticiper, ce sont les chocs à venir entre l’idéologie, comprise comme les croyances et les expériences vécues par les principaux acteurs, et le réel. »