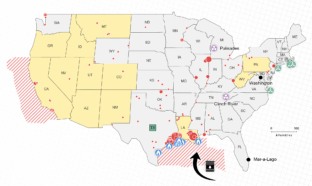Le nucléaire civil russe a été particulièrement épargné par les différents trains de sanctions pris par les Occidentaux depuis l’invasion de l’Ukraine. Et pour cause, cette industrie, aussi stratégique pour le Kremlin que celle du pétrole et du gaz, a tissé depuis des décennies sa toile en Europe, qui peine à s’en affranchir.
C’est un héritage dont les pays d’Europe de l’Est auront bien du mal à se passer. 34 réacteurs de conception soviétique, dits VVER, fonctionnent encore dans les anciens pays satellites de Moscou. La Bulgarie en compte deux, la République tchèque six, l’Ukraine, quinze à elle seule. Tous dépendent de Rosatom, bras armé du nucléaire civil russe, pour assurer la maintenance et l’approvisionnement de leurs installations.
L’invasion de la Crimée par la Russie en 2014 a pourtant marqué un changement de paradigme majeur. « Depuis, tous les pays d’Europe de l’Est, à l’exception notable de la Hongrie, cherchent à changer de fournisseur. Les exploitants de réacteurs VVER ont commencé à faire des stocks de combustibles russes (uranium) en prévision d’un changement progressif », explique Teva Meyer, spécialiste du nucléaire et maître de conférences en géopolitique et géographie à l’Université de Haute-Alsace.
Mais les réacteurs nucléaires n’ont rien de machines standards. Les combustibles nucléaires sont dimensionnés pour chaque réacteur. Trouver de nouveaux fournisseurs d’uranium n’est pas aussi facile que pour le pétrole ou le gaz. Raison pour laquelle sanctionner les « produits nucléaires » russes rendrait quasiment impossible le maintien d’une production stable dans ces pays où la part du nucléaire varie entre 35 et 55 % du mix électrique. La stratégie consiste donc plutôt à s’en affranchir progressivement, en se tournant notamment vers les États-Unis.
Une substitution longue à mettre en place
Constituer une nouvelle chaîne d’approvisionnement ne se fait pas du jour au lendemain. « Westinghouse [spécialiste américain du nucléaire, NDLR] cherche depuis la fin des années 1990 à se positionner en Europe de l’Est pour offrir une alternative à Rosatom », rappelle Teva Meyer. L’affaire est partiellement réussie en Ukraine, où depuis 2014, « tous les réacteurs ukrainiens ont subi des modifications qui en font des hybrides de la technologie russe et américaine », poursuit le chercheur.
Westinghouse est même passé à la vitesse supérieure en novembre 2021 avec un contrat pour la construction du premier réacteur nucléaire ukrainien 100 % américain (AP1000). La compagnie se propose de fabriquer les combustibles nucléaires sur ses sites en Suède et en Espagne.
L’équipementier français Framatome aussi se positionne : le groupe détient une licence accordée par Rosatom en 2021 pour produire sur son site allemand de Lingen des combustibles destinés aux VVER d’Europe de l’Est. Ces barres de combustibles devront passer un parcours d’homologation d’environ cinq ans avant de pouvoir être livrées. Un partenariat qui permet selon le groupe français d’offrir une alternative à Rosatom… bien que ce dernier perçoive des royalties sur ces produits.
Leadership russe sur l’enrichissement
Rosatom est un acteur incontournable sur le marché de l’enrichissement d’uranium puisqu’il contrôlait à lui seul, en 2022, 43 % de la capacité mondiale, devant le britannique Urenco (31 %) et le français Orano (12 %), selon ce dernier. Le russe fournit en combustibles les centrales qu’il vend, mais aussi d’autres clients. Au début de la guerre, 25 % des besoins en uranium enrichi des parcs européens et américains étaient ainsi couverts par des capacités russes.
Et bien que les États-Unis se soient fixé un objectif d’interdiction totale d’importation d’ici 2028, les livraisons, effectuées aujourd’hui sous « licence exceptionnelle », pourraient bien perdurer, car les usines d’enrichissement d’uranium en dehors de la Russie tournent déjà à plein régime. « Orano a un projet d’usine dans le Tennessee et Urenco souhaite augmenter sa capacité de production dans le pays, mais quand bien même ces deux projets verraient le jour, ce ne serait pas suffisant », explique Teva Meyer. Conséquence : « la fin des importations américaines de combustibles nucléaires russes en 2028 est impossible », assure-t-il.
En France, EDF et Orano préfèrent rester discrets sur les volumes d’uranium enrichis importés de Russie. Selon Teva Meyer, les contrats d’importation d’EDF se seraient achevés opportunément avec le début de l’invasion russe en 2022. L’électricien se serait tourné vers Urenco et Orano, qui se fourniraient encore en uranium enrichi auprès de Rosatom pour une partie de leurs besoins… Interrogé sur ce point, le groupe français se contente d’indiquer que « le contrat signé en 2020 pour lui fournir 1 150 tonnes d’uranium recyclé est soldé ».
La base de données des douanes françaises relève cependant que le pays a importé, entre 2021 et 2023, 100 à 300 tonnes par an d’uranium enrichi russe. Des chiffres qui restent difficiles à interpréter, car une part significative de l’uranium importé est destiné à être exporté auprès de clients étrangers : Suède, Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis, Corée du Sud ou Japon.
Souveraineté contre rentabilité
La guerre en Ukraine a fait office d’électrochoc pour un secteur nucléaire qui s’était accommodé du leadership russe sur l’enrichissement. Comme d’autres compagnies occidentales, Orano cherche à profiter du contexte pour gagner des parts de marché. Fin 2024, le groupe a validé le projet d’extension des capacités de production de l’usine d’enrichissement Georges Besse II sur le site de la centrale nucléaire du Tricastin dans la Drôme. Estimé à 1,7 Md€, cet investissement lui permettra d’augmenter ses capacités de production de plus de 30 %, (+2,5 millions d’unités de travail de séparation, d’UTS) pour atteindre 10 millions d’UTS par an.
L’entreprise explique que « ce projet répond aux demandes des clients pour renforcer leur sécurité d’approvisionnement en réduisant la dépendance à la filière russe ». Les premières productions sont prévues dès 2028.
Les industriels, eux, restent prudents. « Pour l’instant, ils n’investissent que dans des capacités additionnelles qu’ils sont sûrs de commercialiser », constate Teva Meyer. En effet, « il y a un doute sur le fait que les négociations sur le conflit en Ukraine ne se traduisent in fine par un retour à un business as usual. Cela est perçu comme un véritable risque géopolitique pour des investissements de long terme car il ne fait pas le moindre doute que l’industrie nucléaire russe restera la moins chère du marché », poursuit-il.
Pas de recyclage sans la Russie
Pour le combustible usagé, la France a choisi la voie du recyclage, alors que beaucoup d’autres s’arrêtent à l’étape du stockage. Cela permet, selon la filière, de réduire de 10 à 15 % les besoins d’uranium naturel.
Suspendue pour des raisons économiques entre 2013 et 2024, la filière française de l’uranium de retraitement enrichi (URE) a repris du service l’année dernière. Désormais, EDF se montre très ambitieux avec un objectif d’alimenter 30 % de ses réacteurs d’ici 2030 – sachant que la France est assise sur un énorme stock de plus de 34 600 tonnes d’uranium de retraitement (c’est-à-dire usagé), note l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra).
Problème, la France dépend entièrement de la Russie pour la phase de ré-enrichissement de l’uranium de retraitement, car la seule usine au monde réalisant l’opération est située en Sibérie, dans la ville de Seversk.
Un monopole qui ne relève pas d’un déficit technologique, assure la Société française pour l’énergie nucléaire (Sfen) : « La France a la maîtrise technique et industrielle de l’ensemble de la chaîne de conversion et d’enrichissement de l’uranium (…) Le choix a été fait, avant la guerre en Ukraine, de sous-traiter ces opérations sur le site de Seversk, de Rosatom où des capacités sont disponibles. Il a été dicté par des raisons économiques et industrielles. »
La filière nucléaire française semble avoir pris conscience du risque que fait peser cette dépendance en matière de recyclage. Jean-Michel Quilichini, directeur de la division combustible nucléaire chez EDF, a confirmé l’année dernière lors d’une convention de la Sfen que des discussions sont en cours avec Orano, mais aussi l’américain Westinghouse pour un projet d’usine capable de se substituer à Seversk. Un tel chantier nécessitera une dizaine d’années. En attendant, la Russie garde les cartes en main.