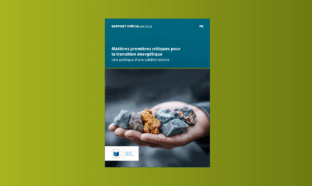Instrument de puissance, l’énergie participe pleinement à la recomposition des rapports de force dans le monde. L’Europe doit intégrer cette nouvelle donne dans la feuille de route pour sa décarbonation et reprendre la main dans le pilotage de son système énergétique, explique Xavier Daval, fondateur et CEO de kiloWattsol, société spécialisée dans le conseil technique solaire.
La transition énergétique n’est pas qu’une affaire de climat ou de technologie. C’est une recomposition des rapports de force mondiaux. À mesure que les États cherchent à décarboner leurs économies, une nouvelle géopolitique se dessine : celle des dépendances énergétiques. Qui contrôle la flexibilité ? Qui fournit les infrastructures d’appoint ? Qui impose ses normes ? Derrière chaque politique climatique, une lutte d’influence s’engage. L’énergie, hier ressource, devient aujourd’hui instrument de puissance.
L’Allemagne, la fin d’un pari gazier
Le modèle allemand reposait sur un triptyque : abandon du nucléaire, montée en puissance massive du solaire et de l’éolien et recours au gaz russe pour équilibrer le tout. L’explosion du gazoduc Nord Stream a brutalement rompu cet équilibre. La fin du gaz bon marché a fragilisé l’Energiewende : flambée des prix, perte de compétitivité, tensions industrielles. Berlin a dû se tourner vers d’autres fournisseurs, souvent au prix fort, pour protéger son appareil productif. Cette crise a rappelé une évidence : la dépendance énergétique reste une arme géopolitique.
La Chine, de la dépendance à la domination
Pendant que l’Europe cherche de nouveaux équilibres, la Chine sécurise ses approvisionnements en gaz russe et consolide sa suprématie industrielle sur les technologies bas carbone. En maîtrisant l’ensemble des chaînes industrielles de la transition – solaire, batteries, terres rares pour les éoliennes, et bientôt hydrogène – et ce des matériaux jusqu’aux normes, Pékin transforme son avance technologique en pouvoir normatif. Bientôt, ce sont peut-être les standards chinois qui définiront ce qu’est une « énergie propre ». L’Europe, jadis prescriptrice, risque de devenir suiveuse. La Chine ne se contente plus d’alimenter la transition : elle en écrit les règles.
Le Pakistan, la révolution solaire décentralisée
Ailleurs, d’autres pays sautent directement à l’étape suivante. Le Pakistan, miné par la dette énergétique et les coupures de courant, a importé en 2024 près de 17 GW de panneaux solaires. Grâce à la baisse des prix et à la fin des taxes d’importation, des millions de toitures produisent désormais de l’électricité à un coût cinq fois inférieur à celui du réseau. Cette révolution silencieuse réduit la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures du Golfe et libère une économie de rue, informelle, qui se reconnecte à la lumière. Pour les ateliers de mécanique, de soudure ou de menuiserie, l’accès à une énergie stable se traduit déjà en points de PIB. Mais elle pose un nouveau défi : comment stabiliser un système désormais partiellement hors réseau ?
Les États-Unis, la manière forte
Pour ne pas perdre la main face à la Chine, les États-Unis déploient une stratégie brutale : ramener l’Europe – jadis pionnière de la transition – dans l’ancien monde carboné tout en se présentant comme son partenaire de sécurité. Face à la crise européenne, Washington a vanté son GNL comme « gaz de liberté », promesse d’indépendance et de solidarité transatlantique. En réalité, ce gaz de schiste, cher et fortement émetteur, installe une nouvelle forme de dépendance. Sous couvert de stabilité énergétique, les États-Unis maintiennent le Vieux Continent dans leur orbite économique, en lui vendant à prix fort un « Made in USA » relocalisé, protégé par des « Big, Beautiful Tariffs » et des clauses locales. Après le collier russe, voici le collier américain – porté par un discours de puissance industrielle qui vise avant tout à prolonger la domination du pétrole, mais tout aussi contraignant dans les faits.
Trois leçons pour l’Europe
De ces trajectoires émergent trois leçons. D’abord, la flexibilité énergétique – qu’elle vienne du gaz, du stockage ou de l’hydrogène – devient un levier stratégique. Celui qui amortit l’intermittence des autres détient un pouvoir sur eux. La flexibilité, c’est la capacité d’un système énergétique à s’adapter en temps réel : à stocker quand la production dépasse la demande et à restituer cette énergie quand le vent tombe ou que le soleil se couche. Elle reposait hier principalement sur le gaz, certes, mais de plus en plus, demain, sur les batteries, l’hydrogène ou la gestion intelligente des réseaux. En pratique, celui qui maîtrise ces leviers décide du rythme de la transition et, donc, exerce une influence directe sur ses partenaires.
Ensuite, la dépendance change de nature : il ne s’agit plus seulement d’importer du carburant, mais de dépendre de systèmes de régulation, de chaînes d’approvisionnement ou de standards étrangers. Enfin, les infrastructures deviennent les nouvelles armes diplomatiques : pipelines, interconnexions, terminaux GNL ou gigafactories pèsent désormais autant qu’un traité international.
L’Europe ne peut prétendre à la souveraineté climatique sans souveraineté énergétique. La feuille de route de la décarbonation, discutée à la veille de la COP30, ne doit pas se limiter aux objectifs d’émission : elle doit intégrer les enjeux de puissance, de sécurité et d’indépendance industrielle. Car celui qui contrôle la flexibilité contrôle le futur. Et l’Europe n’a plus le droit d’en déléguer la clé.