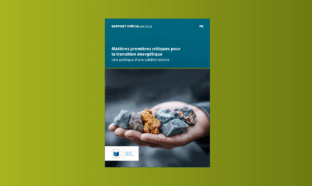L’Allemagne est engagée dans une transformation profonde et difficile de son mix énergétique. Le futur gouvernement va devoir trancher entre gaz, renouvelables, nucléaire ou même charbon.
Le 23 février prochain, les Allemands retourneront aux urnes dans un contexte politique troublé. L’effondrement de la coalition du chancelier Olaf Scholz, réunissant sociaux-démocrates (SPD), libéraux-démocrates (FDP) et Verts, a ouvert une période d’incertitude pour la première économie européenne. Si l’immigration et la récession dominent les débats, la question énergétique s’impose aussi comme un enjeu clé, cristallisant les tensions entre objectifs climatiques, réalités économiques et sécurité d’approvisionnement.
Le nucléaire refait surface
Les partis politiques sont loin d’afficher un consensus sur la direction à prendre en matière de stratégie énergétique. Le SPD reste aligné sur l’objectif d’une sortie du charbon en 2038. Si la CDU/CSU accepte cette ambition, elle insiste sur la nécessité de nouvelles infrastructures gazières et de cogénération pour assurer la transition. L’AFD, ouvertement climatosceptique, défend quant à elle une prolongation de l’exploitation du lignite et du charbon.
Le nucléaire, sujet hautement tabou depuis des décennies, refait surface. Tandis que le SPD et les Verts n’envisagent pas son retour, la CDU/CSU et l’AFD évoquent une relance sous certaines conditions : la CDU/CSU propose d’étudier la réactivation des centrales démantelées et d’investir dans la recherche sur les réacteurs de 4e et 5e générations, les petits réacteurs modulaires et la fusion.
Parallèlement, l’hydrogène s’impose comme un axe stratégique. Le SPD et la CDU/CSU misent sur le développement des infrastructures de stockage et des réseaux pour en faire un vecteur énergétique déterminant. Mais cette solution reste à développer et implique des investissements colossaux.
Le défi de la dépendance au gaz…
Le moment est crucial pour l’Allemagne, engagée depuis plus de deux décennies dans une transformation profonde de son mix énergétique qui se révèle plus difficile que prévu. L’« Energiewende » (transition énergétique), amorcée en 2000 avec la loi sur les énergies renouvelables (EEG), a connu un tournant en 2011 lorsque la chancelière Angela Merkel a acté la sortie du nucléaire à la suite de la catastrophe de Fukushima. Cette promesse a été tenue en avril 2023, scellant la fin du nucléaire à fission en Allemagne. Aujourd’hui, Berlin vise la neutralité carbone en 2045 avec des étapes intermédiaires ambitieuses : une réduction de 65 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, 88 % en 2040 et un mix électrique composé à 80 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2030.
Mais cette ambition se heurte à une réalité difficile : en 2023, 80 % de l’énergie primaire consommée restait d’origine fossile. Et si 55 % de l’électricité provenait de sources décarbonées, le reste était toujours issu du charbon et du gaz. Il reste donc du chemin à faire, et ce n’est pas spécifique à l’Allemagne. Par ailleurs, l’intensité carbone de la production électrique allemande (389 gCO2/kWh) demeure relativement élevée, bien supérieure à celle de la France (56 gCO2/kWh).
Historiquement, l’Allemagne s’est appuyée sur le gaz russe, qui représentait encore deux tiers de ses importations de gaz en 2020. La guerre en Ukraine a brutalement remis en question ce modèle, forçant Berlin à diversifier ses approvisionnements. Aujourd’hui, la Norvège, les Pays-Bas et la Belgique ont pris le relais. En ce qui concerne le gaz naturel liquéfié, qui ne représente que 8 % des importations totales de gaz naturel de 2024, une majorité provenait des États-Unis (91 %).
… et des renouvelables intermittentes
Une autre tension provient du mix électrique allemand, en grande partie composé de renouvelables (54 % en 2023) dont une partie sont intermittentes (PV et éolien). Ainsi, en novembre dernier, un arrêt prolongé de la production éolienne et solaire a provoqué une flambée du prix de l’électricité à 820 €/MWh et une hausse des émissions à 600 gCO2/kWh : ce sont les centrales à charbon qui ont pris le relais sur les renouvelables, ce qui a augmenté considérablement les émissions. Un rappel des limites actuelles du mix électrique allemand qui nécessite des solutions de flexibilité décarbonées pour assurer la stabilité du réseau. Comme par exemple le stockage d’électricité dans des batteries, la flexibilité de la demande ou encore les interconnexions (transferts inter-frontaliers).
L’Allemagne, longtemps exportatrice nette d’électricité, est devenue importatrice nette en 2023 pour la première fois en 21 ans. Un revirement qui met en lumière l’importance des interconnexions transfrontalières avec ses voisins européens. Face à cette fragilité, l’Union européenne a d’ailleurs débloqué fin janvier 1,25 Md€ pour financer 41 projets, dont une interconnexion hybride en mer Baltique avec le Danemark.
Alors que la hausse du coût de l’énergie fait caler le moteur industriel allemand, les élections du 23 février seront déterminantes pour la trajectoire énergétique outre-Rhin. Entre urgence climatique, besoins industriels et pressions géopolitiques, le futur gouvernement devra arbitrer entre pragmatisme et idéal écologique. L’Europe, interdépendante sur le plan énergétique, observe avec attention ces choix. Car au-delà de l’Allemagne, c’est bien l’avenir énergétique du continent qui est en jeu.