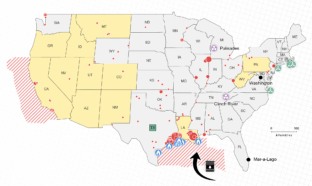Issu de ressources organiques locales, le biogaz occupe une part encore modeste dans la production gazière européenne. Pourtant, cette source d’énergie a l’avantage de répondre à deux défis clés des 27 : la décarbonation et l’indépendance énergétique.
De composition proche du gaz naturel, le biogaz partage avec lui ses principaux usages : produire de la chaleur et de l’électricité. Il contient, entre autres composés, du méthane. Après épuration, ce méthane peut aussi être exploité seul : on parle alors de « biométhane », utilisé comme carburant ou injecté dans le réseau de gaz existant. À la différence de son alter ego fossile, le biogaz est décarboné, issu de ressources organiques locales : résidus agricoles, lisiers, fientes ou fumiers, déchets verts ou de l’agroalimentaire… Il est pour l’instant surtout produit par méthanisation, un processus de fermentation sous l’action de micro-organismes.
Solution miracle ? « Actuellement, le biogaz et le biométhane jouent un rôle assez faible dans le système énergétique mondial », constatait en mai dernier l’Agence internationale de l’énergie (AIE) dans un rapport sur la filière. « Les obstacles logistiques et la complexité des procédures d’autorisation ont freiné l’augmentation de la production dans de nombreux pays. Le biogaz est une ressource décentralisée : le transport de matières premières volumineuses à faible densité énergétique est coûteux. »
L’Europe mise sur la filière
Un grand nombre d’unités sont nécessaires pour atteindre des volumes d’énergie significatifs. Les profils des producteurs s’avèrent d’ailleurs variés entre des exploitations agricoles, des entreprises spécialisées comme Waga Energy, CVE et Keon en France, et des grands groupes comme TotalEnergies, Engie et Suez. L’Europe a beau être le premier producteur mondial de biogaz, avec la moitié des volumes mondiaux en 2023, chiffre l’AIE, « cela représente moins de 2 % de son besoin en gaz ».
Pour autant, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, l’Union européenne compte sur la filière pour réduire sa dépendance au gaz russe. En 2022, elle a fixé l’objectif de produire sur son sol 35 milliards de mètres cubes de biométhane en 2030. À la fin du premier trimestre 2025, elle en était à 7 milliards. Une capacité certes en hausse de 9 % en un an, « mais la croissance commence à ralentir », prévient l’Association européenne du biogaz EBA.
Fait nouveau, la France a dépassé cette année l’Allemagne comme leader en Europe en termes de capacité de production, note l’EBA. Dans les autres grands pays producteurs – Italie, Royaume-Uni, Danemark – le développement a stagné. La France se distingue aussi par la petite taille de ses unités avec une capacité moyenne de 251 m³/h contre 605 m³/h pour l’Allemagne et 727 m³/h pour l’Italie. Au deuxième trimestre 2025, le réseau de gaz français a accueilli 6,4 % de biométhane. Au stade actuel du débat sur sa future programmation énergétique, la France vise 15 % en 2030.
Des procédés innovants émergent
À plus long terme, l’actuelle production par méthanisation ne suffira pas. Des procédés alternatifs émergent. Des techniques de gazéification convertissent par exemple la biomasse en biogaz dans des conditions précises de température et de pression. « La France ne pourra pas faire sans ces filières innovantes », juge Robin Apolit Saget-Borgetto, chargé de mission en France au Syndicat des énergies renouvelables. « Mais nous attendons un cadre pour leur développement. Elles ne bénéficient aujourd’hui d’aucun soutien public. »
Pays pionnier, l’Allemagne s’interroge aussi sur son modèle. De nombreuses centrales de méthanisation y bénéficient d’un dispositif de soutien arrivant à échéance. Berlin veut par ailleurs réorienter sa filière vers de nouvelles matières premières. Contrairement à la France, elle exploitait principalement jusqu’ici des cultures agricoles dédiées pour alimenter ses méthaniseurs, et compte, à l’avenir, privilégier des ressources plus « durables », tels que les déchets agricoles et municipaux.