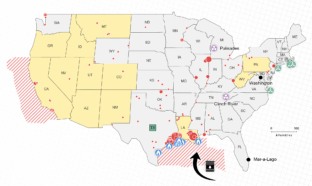Alors que les réseaux électriques sont soumis à de nouveaux enjeux liés à la montée en puissance des énergies renouvelables intermittentes, l’hydroélectricité suscite un grand intérêt. La France dispose d’un parc important mais bataille contre Bruxelles pour garder la propriété de ses installations.
Ce n’est pas la plus récente ni la plus médiatisée, mais c’est de loin la première source de production d’énergie renouvelable en France. L’hydroélectricité offre trois avantages clés : prévisibilité, flexibilité et capacité de stockage. De sérieux atouts à l’heure où l’essor du solaire et de l’éolien nécessite une adaptation des réseaux électriques. Le nouveau PDG d’EDF, Bernard Fontana, en fait d’ailleurs une priorité de son mandat comme il l’a récemment expliqué lors de ses auditions par les députés et les sénateurs : il compte moderniser le parc hydroélectrique pour en augmenter sa capacité de production et de flexibilité et éviter les risques de désoptimisation des installations.
Un patrimoine stratégique
Aujourd’hui, le parc français, développé dès les années 1940, représente environ 26 GW de capacité installée et assure autour de 15 % de la production d’électricité nationale. Il comprend plusieurs types d’exploitation qui remplissent des rôles variés et essentiels. Les grands ouvrages fluviaux, par exemple, qui fonctionnent au fil de l’eau, assurent une production de base stable, mais nécessitent une gestion coordonnée, notamment en lien avec la navigation. Ces installations offrent une souplesse d’utilisation, ce qui est fondamental pour l’équilibre offre-demande d’électricité.
Les stations de pompage-turbinage (STEP) jouent quant à elles un rôle clé dans le stockage de l’énergie. Elles permettent de répondre aux besoins fluctuants du réseau en stockant de l’énergie lors des périodes creuses pour la restituer pendant les pics de consommation. Elles sont essentielles pour la bonne intégration des énergies renouvelables variables dans le mix, en assurant une gestion flexible du réseau.
Le régime des concessions en crise
Ces installations appartiennent pour la plupart à l’État et sont exploitées dans le cadre d’un régime de concessions. Les trois principaux bénéficiaires sont EDF (70 % de la puissance hydroélectrique nationale), la Compagnie nationale du Rhône (CNR, 25 %) et la Société hydroélectrique du Midi (SHEM, filiale d’Engie, 3 %). Sur les 340 concessions hydroélectriques, représentant 90 % du parc national, 61 arrivent à échéance fin 2025.
Or ce régime – et EDF en première ligne – est dans le collimateur de Bruxelles : la Commission européenne a engagé deux procédures de précontentieux en 2015 et 2019, accusant l’électricien national d’abus de position dominante et dénonçant l’absence de mise en concurrence. Ces procédures, bien qu’encore non transformées en contentieux, créent une incertitude juridique qui bloque les investissements nécessaires à la modernisation du parc, comme le constate une mission d’information de l’Assemblée nationale qui vient de publier un rapport sur le sujet le 13 mai dernier.
Bras de fer avec Bruxelles
La solution actuelle, basée sur les « délais glissants », autorise une prolongation temporaire des concessions mais ne permet pas un renouvellement efficace et durable du parc qui a besoin d’investissements de long terme. Comment sortir de l’impasse juridique ? Trois options sont à l’étude : la mise en concurrence, la quasi-régie ou le régime d’autorisation. Dans la ligne de ce que souhaite l’État et les concessionnaires, la mission parlementaire préconise de passer à un régime d’autorisation et de défendre, au niveau européen, une révision de la directive « Concessions » qui empêche d’effectuer des travaux trop importants sur une installation sans remise en concurrence.
L’urgence est d’autant plus forte que si les capacités existantes sont en grande partie exploitées, il reste des opportunités pour augmenter la production, notamment grâce à la mise en service de nouvelles stations de pompage-turbinage. La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) envisage ainsi la mise en service de 1,5 GW de nouvelles capacités de STEP d’ici 2035.
En outre, la modernisation des installations existantes, par l’ajout de nouvelles turbines ou l’optimisation de la gestion des ressources en eau, pourrait permettre une augmentation de la production tout en préservant les écosystèmes et en tenant compte des autres usages de l’eau, comme l’irrigation ou la navigation.