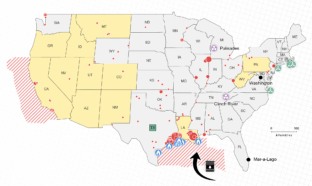Près de la moitié de la population du continent n’a pas accès à l’électricité. Alors que les réseaux existants sont largement insuffisants, les systèmes solaires autonomes offrent une solution alternative, mais encore modeste.
Le chiffre est impressionnant : près de 600 millions de personnes vivent sans électricité en Afrique. En 2023, seulement 53,3 % de la population de la zone subsaharienne y avait accès, 83 % en territoires urbains contre seulement 33,9 % en territoires ruraux, selon la Chinese Loans to Africa Database.
L’Afrique n’est pourtant pas dépourvue de réseaux électriques. Elle en compte cinq internationaux, tous sous un statut public et développés à une échelle régionale : le Southern African Power Pool (SAPP), le West African Power Pool (WAPP), l’Eastern Africa Power Pool (EAPP), le Central African Power Pool (CAPP) et le Comelec au Maghreb.
Mais ils ne comblent pas 100 % des besoins des États couverts et ne sont pas ou peu connectés entre eux. En outre, leurs capacités sont très inégales tout comme la contribution des États à la production, ce qui provoque des déséquilibres inter et intra-pools. Le Comelec et le SAPP sont de loin les plus performants, tandis que le CAPP est sous-développé. Conséquence : la République démocratique du Congo (RDC) a l’un des taux d’électrification les plus faibles du continent et cherche à devenir un point d’échange entre plusieurs pools pour multiplier ses sources d’électricité. A contrario, certains pays occupent des positions dominantes au sein de leur réseau : l’Afrique du Sud sur le SAPP ou l’Éthiopie sur l’EAPP, ce qui leur confère un instrument de puissance, créant des rapports de force.
Autre difficulté, ces réseaux couvrent essentiellement des zones urbaines ou périurbaines et ne raccordent que rarement des communes rurales ou reculées. Se pose aussi la question de leur fiabilité, cruciale en termes de sécurité et développement. C’est dans ce contexte que l’Union africaine a lancé le marché unique de l’électricité, preuve d’une volonté d’intégration continentale mais qui ne verra pas le jour avant… 2040. Car les tentatives d’intégration se heurtent à plusieurs obstacles : des infrastructures disparates, parfois vieillissantes, des incompatibilités de transmission et des discordances réglementaires. Sans oublier le nerf de la guerre : le manque d’investissements.
Des difficultés de financement
Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), entre 2023 et 2030, 22 Mds$/an seraient nécessaires pour connecter l’ensemble de la population africaine à l’électricité. Or, les fonds alloués aux réseaux électriques restent très insuffisants, notamment ceux issus du secteur privé, dédiés en priorité à la production, au détriment de la distribution ou de l’extension des réseaux. Selon l’AIE, le secteur privé devrait multiplier par 2,5 ses investissements entre 2022 et 2030 pour répondre aux besoins du continent. La mobilisation de bailleurs de fonds est donc cruciale. La Banque africaine de développement et la Banque mondiale ont ainsi lancé la « Mission 300 » dont l’objectif est de raccorder 300 millions de personnes à l’électricité d’ici à 2030 en Afrique subsaharienne.
Un État a particulièrement bien compris cet enjeu et la place centrale qu’il pouvait gagner : la Chine. Entre 2000 et 2023, Pékin a alloué 14 Mds$ de prêts pour l’extension des réseaux électriques en Afrique et près de 43 Mds$ pour un accès étendu à l’électricité, d’après la Chinese Loans to Africa Database, essentiellement pour la production d’énergie solaire. Mais la facture est salée : les pays africains ont déjà accumulé une « dette énergétique » de près de 35 Mds$ vis-à-vis de la Chine et une dette politique non-quantifiable vis-à-vis de Pékin….
Le off-grid, une alternative en plein boom
Face au manque d’argent, les États africains se tournent vers une solution alternative : des systèmes de production d’électricité autonomes, d’origine solaire, sans raccordement à un réseau, d’où leur nom de « hors réseau » (ou off-grid). Entre 2020 et 2022, la Banque mondiale indique que 55 % des nouvelles connexions électriques en Afrique subsaharienne étaient issues de ce dispositif, plus rapide et moins coûteux à déployer. Les kits solaires sont particulièrement plébiscités, l’Afrique abritant 60 % des ressources photovoltaïques mondiales. Ils fonctionnent selon le modèle de tarification à l’usage, dit « Pay as you go », dans lequel le consommateur paye uniquement ce qu’il consomme, généralement via son téléphone portable.
Sur ce marché, la Chine occupe une place beaucoup plus modeste : en 2023, Pékin a annoncé le financement de systèmes solaires off-grid à hauteur de 14 M$ pour alimenter 50 000 foyers en Afrique. Une goutte d’eau… A contrario, des entreprises européennes, dont le français Engie ou les britanniques Bboxx et M-Kopa, se sont taillé une place de choix sur ce marché, de même que quelques sociétés africaines. Reste que ces opérateurs qui pourraient assurer une électrification plus rapide, souveraine et décarbonée des États africains souffrent de la faiblesse des mécanismes de subvention et pâtissent d’une rentabilité limitée. Le chemin vers une Afrique 100 % connectée reste semé d’embûches.